
Une nouvelle approche, considérant la disponibilité des éléments nutritifs pour la plante, non plus comme un facteur externe à celle-ci, uniquement contrôlé par les apports de fertilisants et par leurs interactions physico-chimiques avec la matrice minérale du sol, mais comme une propriété émergente* du système plante – sol – microbiome*, permet de partir du diagnostic in situ de l’état de nutrition de la culture, qui de fait intègre la variabilité contextuelle et permet donc d’inférer avec une incertitude beaucoup plus faible les besoins en apports d’engrais des cultures et du même coup les risques environnementaux qui leur sont associés. Introduction Depuis le début des années 1950, les rendements en grain des principales cultures nécessaires directement ou indirectement à l’alimentation humaine ont été multipliés par un facteur 10, en grande partie grâce à une augmentation d’un facteur 7 de l’utilisation des engrais azotés et d’un facteur 3,5 de celle des engrais phosphatés (Tilman et al., 2002). Il s’agit donc d’un indéniable succès permettant de nourrir une population humaine toujours croissante sur des surfaces cultivables limitées. Cependant ce succès atteint aujourd’hui ses limites pour au moins deux raisons majeures : (1) La limitation des ressources en éléments fertilisants du fait que l’azote (N), essentiellement fourni par la réduction industrielle du N2 atmosphérique en ammoniac est en réalité une ressource limitée à l’avenir du fait de son coût en énergie fossile et des émissions de gaz à effet de serre qui accompagnent ce procédé industriel ; et du fait que le phosphore (P) et le potassium (K) sont extraits de minerais dont la ressource est limitée à l’échelle du globe. (2) La faible efficience d’utilisation des deux éléments N et P dans les systèmes agricoles, qui conduit à des augmentations excessives de leur circulation au sein des agro-écosystèmes, provoquant des impacts négatifs en cascade dans l’environnement (Galloway & Cowling, 2002). Les recherches sur la nutrition minérale et la fertilisation des cultures ont été menées sur la base des paradigmes* issus des travaux pionniers de Boussingault (1855) et de Liebig (1855) au milieu du XIXe siècle. Ces paradigmes avaient pour objet la réponse des plantes et des cultures à des apports exogènes d’éléments minéraux sous formes d’engrais. L’aspect endogène de la disponibilité de ces éléments dans la dynamique de fonctionnement du système sol – plante – microbiote* du sol n’était donc pas pris en compte, et par conséquent les courbes de réponse obtenues expérimentalement étaient fortement dépendantes du contexte local sol – climat – plante et donc éminemment variables dans l’espace et dans le temps. Face à cette variabilité, l’utilisation des courbes de réponse comme outils de pronostic pour l’établissement des règles de fertilisation a donc engendré une forte incertitude qui a incité les prescripteurs et les agriculteurs à apporter des quantités d’engrais souvent excédentaires pour être certain de satisfaire « à coup sûr » les besoins de leurs cultures (Ravier et al., 2016). Cette pratique, encouragée par un faible prix des engrais comparé à ceux des produits agricoles, a conduit d’une part à négliger l’utilisation des déjections animales comme source d’éléments fertilisants, et d’autre part à des excès de fertilisation minérale qui, cumulés au cours des années, sont responsables des flux excessifs de N et P dans l’environnement observés aujourd’hui. Il convient donc de re-questionner les paradigmes initiaux sur lesquels l’agronomie s’est en partie fondée en matière de nutrition minérale et de fertilisation des cultures, afin de réintroduire une vision plus dynamique du fonctionnement du système sol – plante - micro-organismes, qui puisse prendre en compte non seulement la réponse des plantes à des apports exogènes d’éléments nutritifs, mais aussi les nombreuses rétroactions endogènes qui confèrent au système ses propriétés adaptatives.
Sous categorie : Soil analysis
Tags:

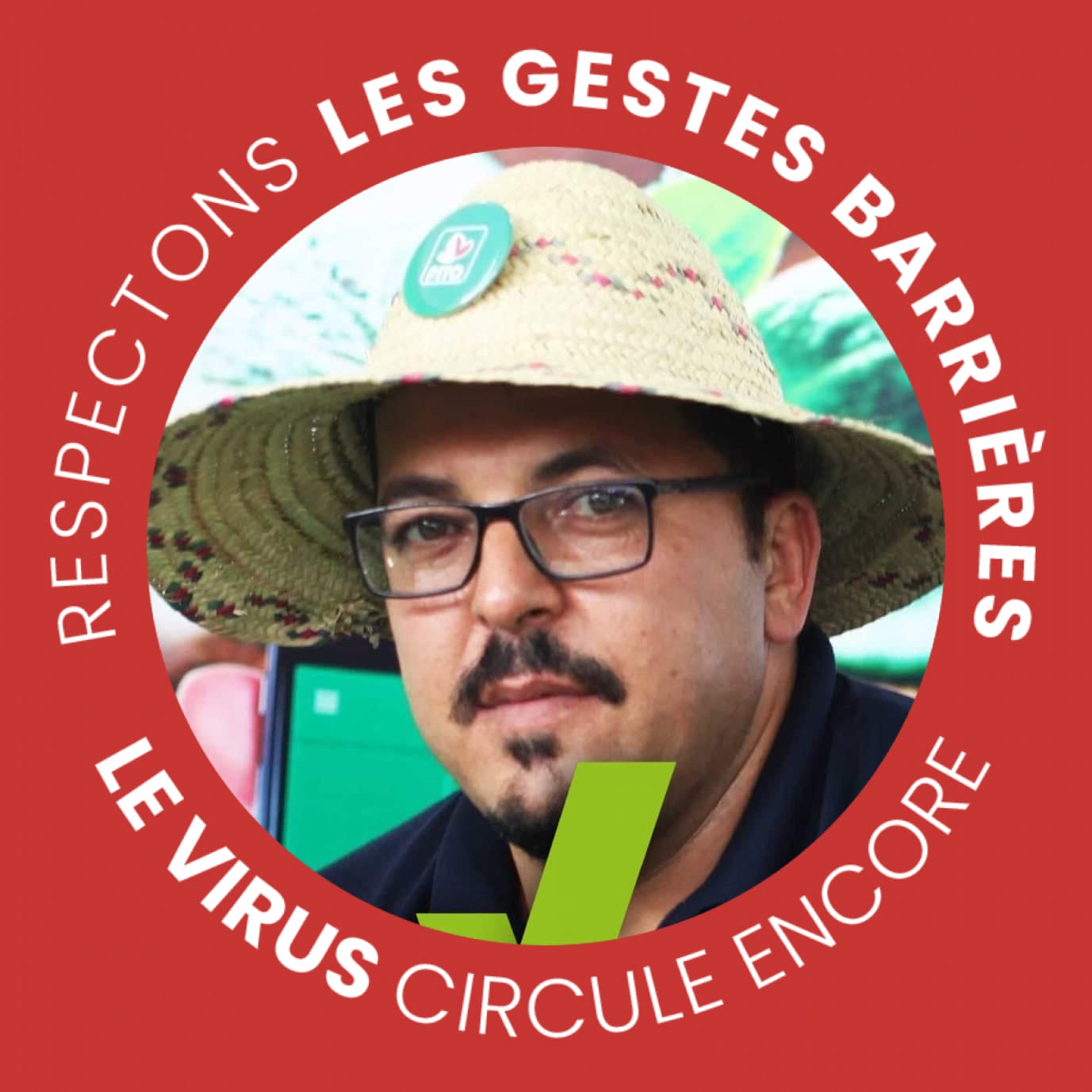






0 Comments